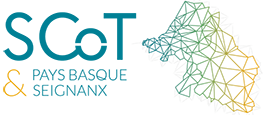le Syndicat Mixte du SCoT poursuit son cycle de séminaires sur la « résilience du territoire » avec l’appui du Cerema et d’AcclimaTerra en se questionnant sur la mise en pratique de la lutte contre l’étalement urbain.

Le 2 octobre 2022, plus d’une centaine d’élus et de techniciens se sont réunis pour :
- S’interroger sur comment atteindre le Zéro Artificialisation Nette dit ZAN en 2050 tout en répondant aux besoins résidentiels mais aussi économiques, sur un territoire attractif qui souhaite apaiser le développement littoral et réinvestir les petites villes de l’intérieur ?
- Comprendre les contraintes et les stratégies de chacun pour
mieux construire collectivement les actions à mener, en fonction
de nos spécificités.
Résilience et sobriété foncière, de quoi parle-t-on exactement ?
L’étalement urbain est l’une des premières causes de l’érosion de la biodiversité en France, et participe activement au dérèglement climatique ; en parallèle, les effets du dérèglement climatique et l’érosion du vivant rende la ville moins agréable à vivre, voire nocive.
L’Etat Français, via la promulgation de la loi Climat & Résilience, souhaite accélérer la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF). Cette loi décline une approche comptable stricte (la déclinaison d’objectifs chiffrés pour atteindre le ZAN en 2050), complétée d’une dimension qualitative aux contours plus flous. Afin de préciser ces enjeux qualitatifs, le Syndicat Mixte du SCoT a souhaité faire dialoguer différentes approches : politiques, techniques, économiques, sociales ou encore écologiques.
La matinée a permis de poser les enjeux dans leur globalité, puis à revenir sur leurs aspects opérationnels localement (table ronde).
Les interventions de :
- Marie DEFAY, Economiste-Urbaniste
- Edouard DEQUEKER, Chaire d’économie urbaine ESSEC
- David MIET, Villes vivantes
ont montré comment il était possible de réduire notre consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et en quoi ce changement de modèle est une opportunité auservice d’une ville plus vivante et conviviale.
A la suite de ces interventions, une table ronde composée de divers acteurs locaux ont mis en lumière des points de vue différents mais une volonté commune réelle de faire avancer le débat et de proposer des solutions pratiques voire innovantes.
Les ateliers de l’après-midi ont couvert plusieurs thèmes en simultané :
- Quels modèles économiques pour faire "ZAN" (Zéro Artificialisation Nette)?
- Comment réinvestir les espaces déjà urbanisés des villes et des bourgs ?
- Comment répondre aux besoins en logements sociaux sur l’ensemble du territoire ?
- Comment rendre désirables les formes compactes ?
- Comment renaturer les espaces déjà urbanisés ?

Que retenir des échanges et des conclusions du séminaire ?
Les échanges de cette journée ont permis de définir des constats et des pistes d’actions :
1. Quels modèles économiques pour faire "ZAN" ?
Cet atelier a mis en lumière la nécessaire solidarité à engager au sein du territoire du SCoT pour atteindre l’objectif d’une réduction de 50 % de la consommation d’ici 2031. Il a aussi montré l’importance de mettre en perspective les coûts du réinvestissement des tissus existants et les coûts de l’étalement urbain (les coûts « directs » actuellement pris en charge par la collectivité comme l’extension et l’entretien des voiries et les coûts « indirects » tels que la perte de la biodiversité, la perte d’espaces agricoles et des productions associées, les coûts sociaux) afin de comprendre et de s’engager pour le « ZAN ».
2. Comment réinvestir les espaces déjà urbanisés des villes et des bourgs ?
Globalement, les participants à l’atelier ont exprimé la nécessité de travailler des projets urbains avant tout en tenant compte du contexte, dans une perspective davantage qualitative que quantitative, ce qui est fortement compliqué par les injonctions législatives et réglementaires (ZAN, loi SRU, etc.). Cet atelier a proposé différents outils qu’il trouverait utile de développer :
-
- Le partage de la connaissance sur les logements vacants ou sous-utilisés (observatoires, échanges entre territoire…)
- Le diagnostic de l’immobilier public,
- Le lancement de dispositifs d’accompagnement et de concentration d’aides financières destiné à inciter et accélérer la rénovation de l’habitat (OPAH RU), au moins sur les communes qui jouent un rôle de centralité
- La mise en place d’une stratégie foncière spécifique
- Une meilleure connaissance pour les communes des dispositifs d’aides pour qu’elles puissent plus facilement aider les propriétaires privés
- L’acquisition de connaissance des sols et sous-sols
3. Comment répondre aux besoins en logements sociaux sur l’ensemble du territoire ?
Cet atelier a retenu le constat d’une tension grandissante partagée mais nuancée par les opérateurs, qui en appelle à la solidarité territoriale pour trouver le juste équilibre entre les opérations sociales menées sur le littoral et celles menées à l’intérieur.
4. Comment rendre désirables les formes compactes ?
Cet atelier a retenu plusieurs pistes concernant :
-
- la conception des projets pour, par exemple, promouvoir des formes urbaines compactes, adaptées, adaptables et diversifiées (non aux solutions uniques ou uniformes !), penser des projets contextualisés, adaptés à leur environnement et à taille humaine pour veiller à la qualité et à l’adaptabilité des logements, gérer l’intimité et la promiscuité à l’îlot, participer à une armature (inter)communale d’espaces collectifs et d’espaces verts, réinterpréter les modèles anciens…
- le cadrage politique et règlementaire qui devrait traduire un haut niveau d’exigence à atteindre en termes qualitatifs pour les projets urbains et faciliter le travail partenarial
- la nécessité de créer du lien dans et par le projet, par exemple, entre populations résidentes et nouveaux habitants pour mieux accepter les projets et les formes urbaines proposées.
5. Comment renaturer les espaces déjà urbanisés ?
Cet atelier a déterminé les conditions qui lui semblent indispensables pour renaturer de manière efficace et qualitative ainsi que des objectifs à atteindre dans le temps :
-
- Mieux connaître le potentiel de renaturation des espaces urbains
- Planter beaucoup, mais planter local
- Sensibiliser pour mobiliser
- Développer des coopératives biodiversité